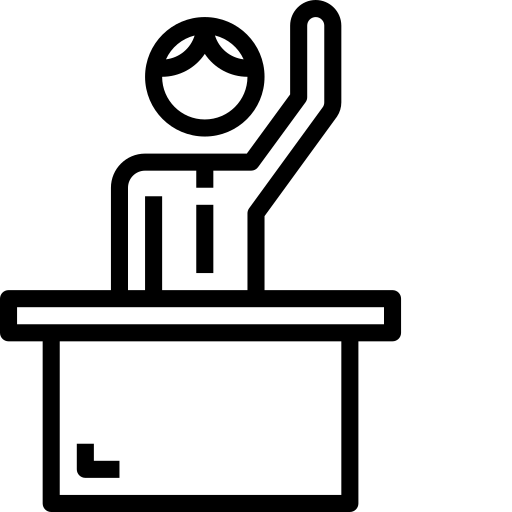Bourse/Finance
Très hauts salaires : ce que révèle vraiment la dernière étude de l’INSEE
L’INSEE vient de dévoiler un panorama rare et très documenté des hauts et très hauts salaires en France, en s’intéressant aussi bien aux niveaux de rémunération qu’aux trajectoires professionnelles de ceux qui les perçoivent. Les conclusions, tirées des données 2022 et 2023, dessinent une réalité sociale nettement plus stable, concentrée et peu perméable qu'on ne le pense souvent : les salariés du « top 1 % » ne sont pas apparus par surprise au sommet de l’échelle, ils y étaient déjà il y a quinze ans.
Selon l’étude, un salarié du secteur privé est considéré comme « très haut salaire » lorsqu’il perçoit au moins 10 219 euros nets par mois en équivalent temps plein. Cela ne concerne qu’un poste sur cent, et l’on tombe à des chiffres encore plus impressionnants lorsqu’on observe le 0,1 % supérieur : leur revenu mensuel dépasse 27 066 euros nets, soit près de vingt fois le SMIC. Les mille postes les mieux rémunérés dépassent 114 584 euros nets mensuels. Les cent premiers culminent au-delà de 312 000 euros nets par mois. Une France minuscule, mais dont les salaires, à eux seuls, illustrent la force de concentration du haut de la distribution.
Le portrait-robot de ces salariés confirme l'extrême homogénéité du groupe. L’âge est un marqueur fort : la majorité a plus de 50 ans, souvent installée depuis longtemps dans des fonctions stratégiques. Le genre souligne un écart persistant : seulement 24 % des salariés dépassant les 10 219 euros nets mensuels sont des femmes, alors qu’elles représentent 42 % des salariés du privé en équivalent temps plein. La géographie joue également un rôle décisif.
Concentration parisienne
L’essentiel de ces très hauts salaires se concentre en Île-de-France, reflet de la présence des sièges sociaux, des métiers de direction, du conseil, de la finance, ou encore de la technologie. Quant aux entreprises concernées, il s’agit majoritairement de grandes structures, souvent internationales, dans lesquelles les rémunérations intègrent des composantes variables substantielles : primes, bonus, parts variables indexées sur la performance.
La grande révélation de l’étude réside toutefois dans l’analyse des trajectoires. Neuf salariés sur dix appartenant au top 1 % en 2022 figuraient déjà, quinze ans plus tôt, parmi les 10 % les mieux rémunérés de leur génération. Autrement dit, l’accès aux très hauts salaires ne résulte que très marginalement d’une ascension fulgurante ou d’un changement de cap tardif. Il s’agit au contraire de parcours longs, d’une accumulation progressive de capital humain, de responsabilités, de mobilité interne ou sectorielle, souvent dans les mêmes environnements professionnels. L’idée d’un sommet accessible à tous, à tout moment, se heurte aux chiffres : la mobilité ascendante existe, mais elle est lente et limitée.
L’INSEE souligne paradoxalement que ces salariés très bien rémunérés connaissent une plus forte volatilité annuelle de leurs revenus. La dépendance aux rémunérations variables, propres aux métiers de direction ou de conseil, explique cette instabilité. Mais cette volatilité ne remet pas en cause la position dans la hiérarchie salariale : un choc de rémunération peut faire baisser le revenu sur une année, rarement la place dans l’échelle.
Cette photographie s’inscrit par ailleurs dans une tendance plus large observable dans les données fiscales. Entre 2003 et 2022, les très hauts revenus ont progressé beaucoup plus vite que ceux de l’ensemble des foyers : +119 % en euros courants, contre +46 %. Leur structure a profondément changé : les salaires ne représentent plus que 38 % de leurs revenus, une part en forte baisse, tandis que les revenus du capital – dividendes, intérêts, plus-values – comptent désormais pour près de la moitié. Ce basculement rappelle que la frontière entre très hauts salaires, hauts revenus et hauts patrimoines est poreuse.
Une grille de lecture de la société
L’étude soulève également des questions de politique publique et d’organisation sociale. La sous-représentation persistante des femmes dans les rémunérations extrêmes renvoie à des problématiques d’accès aux responsabilités, de plafond de verre, et d’interruptions de carrière. La forte concentration géographique interroge l’attractivité économique du reste du territoire. Et la faible mobilité inter-générationnelle du haut de l’échelle souligne la difficulté d’élargir l’accès aux plus hauts niveaux de rémunération, même à diplôme équivalent.
Cette publication de l’INSEE n’est pas seulement une photographie des salaires les plus élevés. Elle offre une grille de lecture sur la façon dont se construisent les élites économiques françaises, sur la stabilité des positions acquises, et sur les conditions réelles qui permettent – ou non – d’y accéder. En cela, elle éclaire autant le débat social que le débat économique, et rappelle une réalité simple : le sommet de la pyramide salariale est extrêmement étroit, stable, et rarement un produit du hasard.

.png)
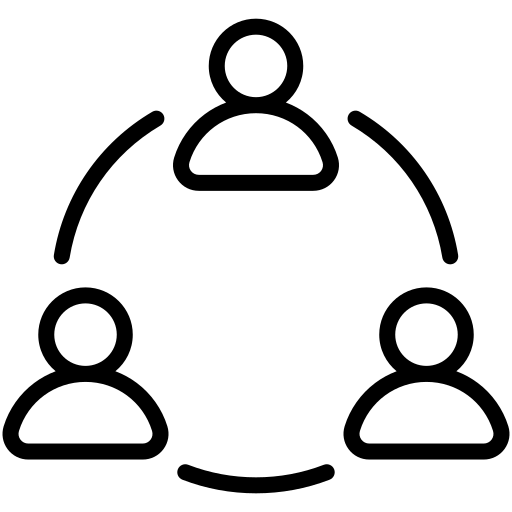
.png)
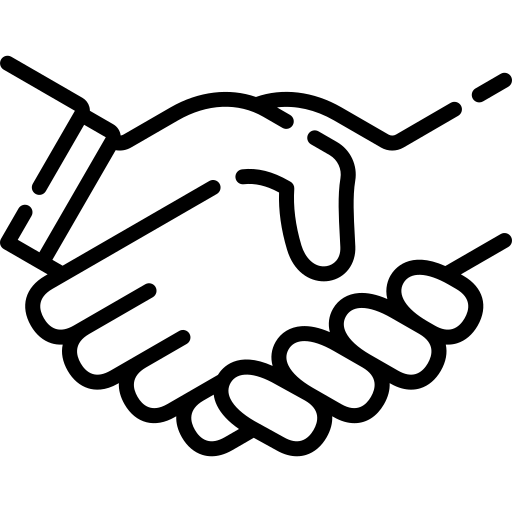
.png)
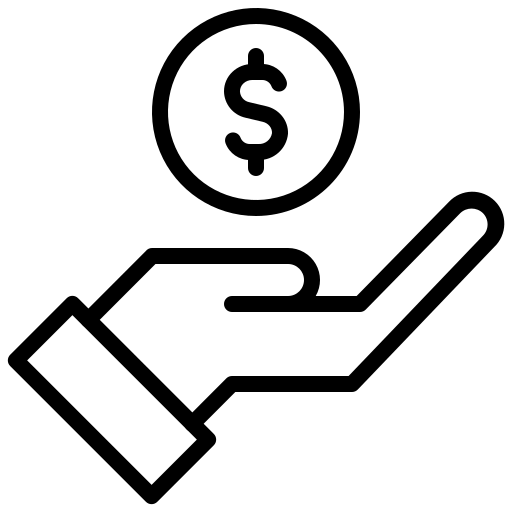
.png)
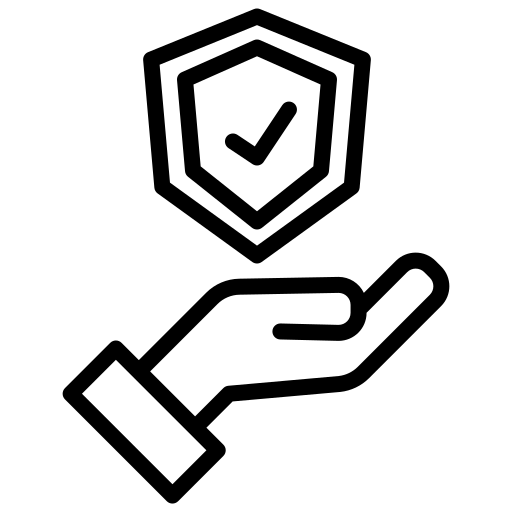
.png)
.png)
.png)
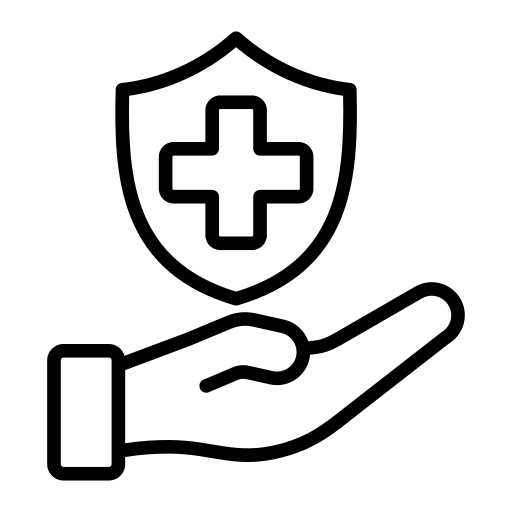
.png)
.png)
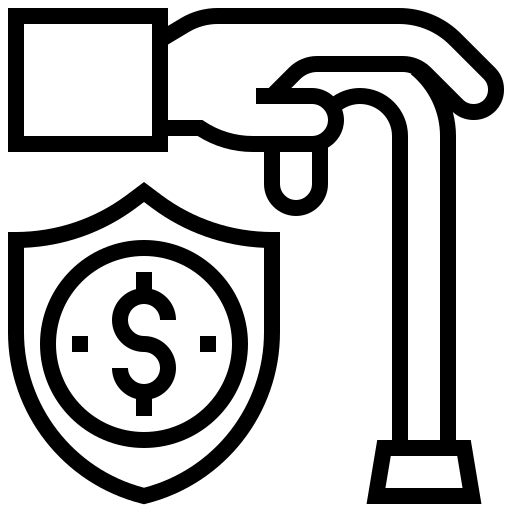
.png)
.png)