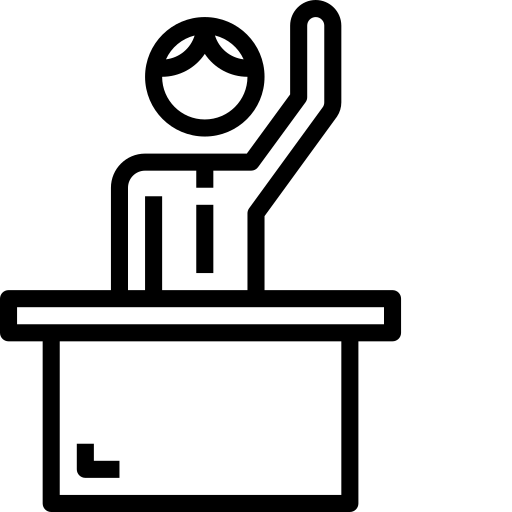Retraite
Rentrée française : Un record d'épargne des ménages
Au deuxième trimestre 2025, le taux d’épargne des ménages a atteint 18,9 % du revenu disponible brut, selon l’Insee. Un niveau inédit depuis les années 1980 (hors parenthèse Covid), qui illustre le climat de défiance face aux crises successives et à l’incertitude politique. Entre prudence budgétaire, vieillissement démographique et attrait retrouvé des produits financiers, les Français consolident leur réputation de « fourmis » de l’Europe.
Un comportement dicté par l’accumulation des crises
Depuis la crise sanitaire de 2020, le taux d’épargne n’est jamais revenu à son niveau d’avant-Covid, autour de 15 %. Au contraire, il s’est installé durablement au-dessus de 17 %, franchissant un nouveau cap à 18,9 % entre avril et juin 2025. Dans le détail, le taux d’épargne financière progresse aussi, de 9,5 % à 9,8 % du revenu disponible brut.
« Nous observons une prudence structurelle des ménages, nourrie par la succession de chocs macroéconomiques », analyse Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne. Guerre en Ukraine, vague inflationniste, tensions au Moyen-Orient, crise politique en France : autant d’éléments qui incitent les ménages à différer leurs achats importants, à thésauriser leurs gains de pouvoir d’achat et à privilégier l’épargne de précaution.
Ce réflexe est renforcé par la mémoire récente de la flambée des prix. Même si l’inflation est revenue à 2,4 % en rythme annuel, beaucoup de ménages gardent en tête la perte de pouvoir d’achat subie entre 2021 et 2023. Résultat : la consommation reste bridée, notamment sur l’équipement du logement et les biens durables.
Vieillissement, fiscalité et attrait des placements
Au-delà des crises, d’autres facteurs structurels pèsent. Le vieillissement de la population entraîne un réflexe d’épargne retraite, renforcé par le développement du Plan d’épargne retraite (PER) et des placements de long terme. Les ménages de plus de 50 ans sont les plus gros contributeurs à la hausse du taux d’épargne, car ils réinvestissent massivement les revenus de leurs contrats d’assurance vie ou de leurs livrets.
La crainte d’une hausse des impôts, liée à la dégradation des comptes publics (déficit supérieur à 5 % du PIB), incite également à mettre de côté. Certains ménages redoutent des prélèvements supplémentaires pour financer les retraites ou le remboursement de la dette. Enfin, l’environnement financier joue un rôle décisif : les taux d’intérêt élevés depuis 2023 rendent l’épargne liquide plus attractive. Le Livret A, rémunéré à 3 % jusqu’à fin janvier 2025, a drainé plus de 20 milliards d’euros de dépôts supplémentaires depuis le début de l’année.
Une prudence installée dans la durée
La résilience des Français face aux crises ne se traduit pas par un retour à l’insouciance, mais par une prudence de long terme. L’annonce surprise de François Bayrou le 25 août, confirmant le lancement d’une réforme fiscale d’ampleur en 2026, n’a fait que renforcer cette attitude attentiste. Il est reconnu que les familles continueront à économiser tant que la situation économique et fiscale demeurera incertaine.
Comparée à ses voisins, la France affiche l’un des taux d’épargne les plus élevés d’Europe : l’Allemagne et les Pays-Bas se situent autour de 15 %, l’Italie à 11 % et l’Espagne à 9 %. Si cet excédent d’épargne est une force pour le financement de l’économie, il traduit aussi une consommation bridée, qui pèse sur la croissance. Le paradoxe français, c’est que l’épargne est abondante mais insuffisamment orientée vers l’investissement productif.
Reste à savoir si ce comportement est conjoncturel ou durable. Pour beaucoup d’analystes, la prudence s’installe dans les mentalités : la succession de crises depuis quinze ans (subprime, dette souveraine, Covid, inflation, instabilité politique) a redéfini les normes de gestion budgétaire des ménages. Une « nouvelle normalité » qui pourrait marquer durablement l’économie française.

.png)
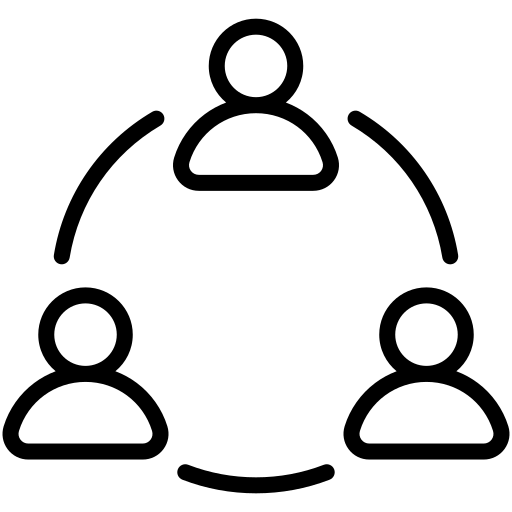
.png)
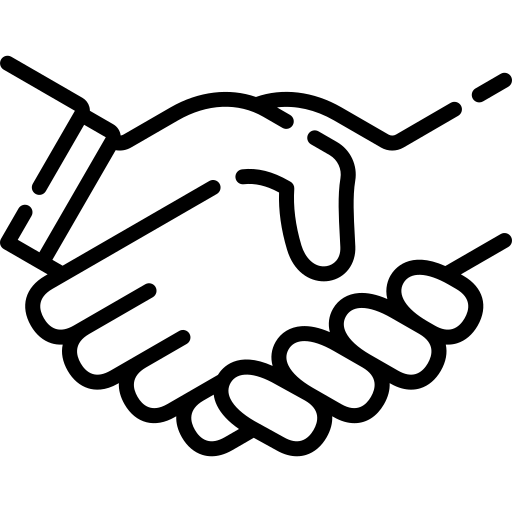
.png)
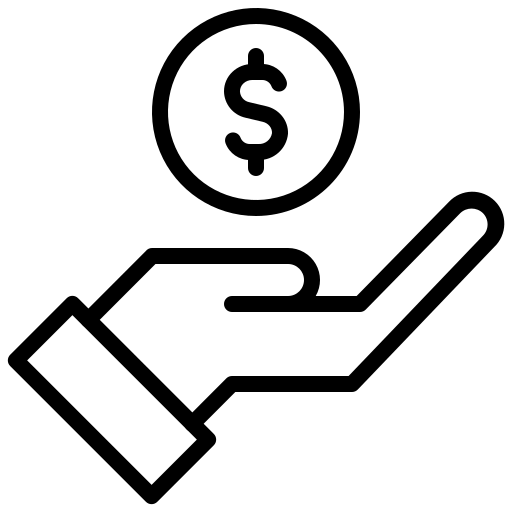
.png)
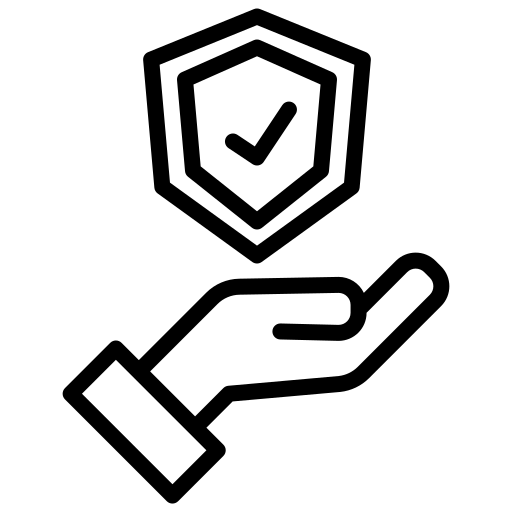
.png)
.png)
.png)
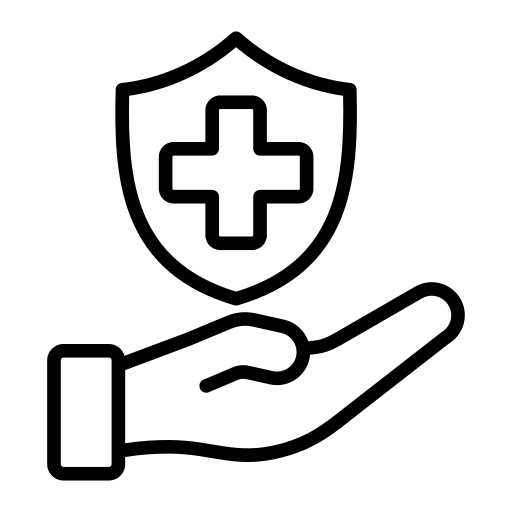
.png)
.png)
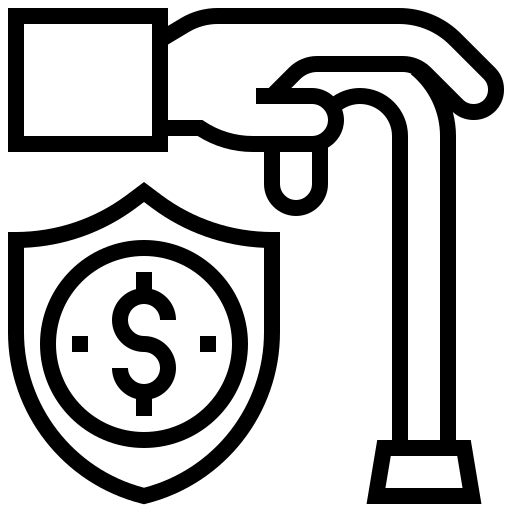
.png)
.png)